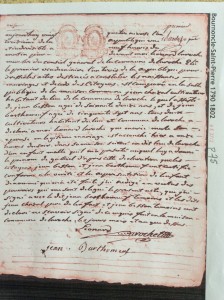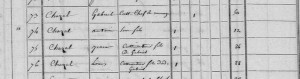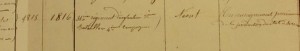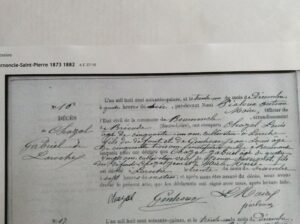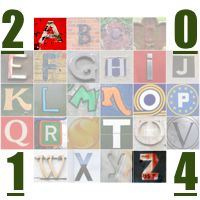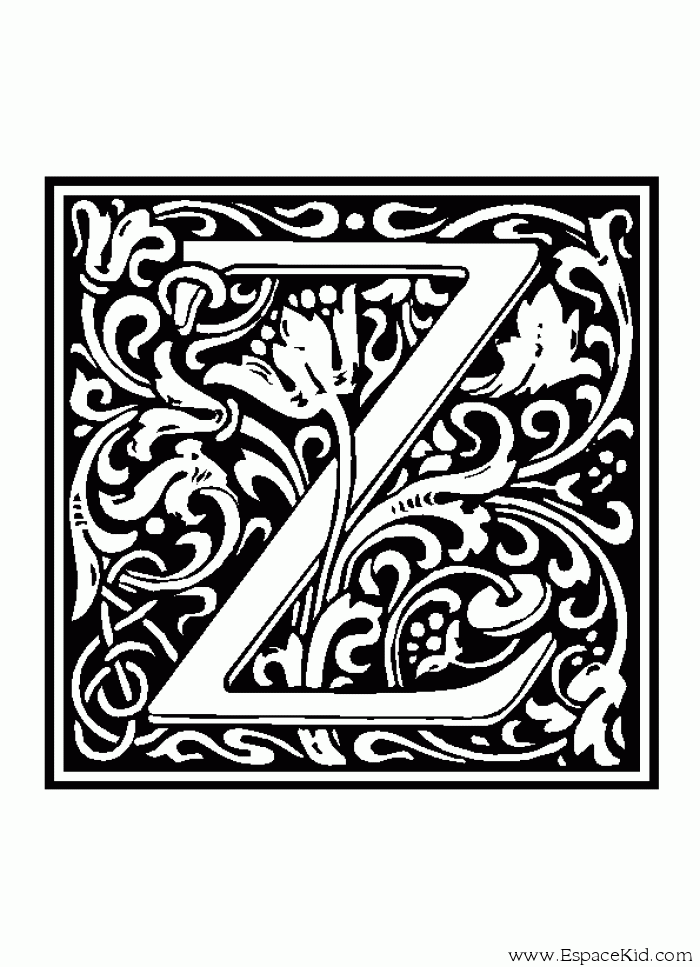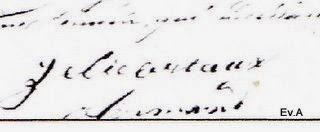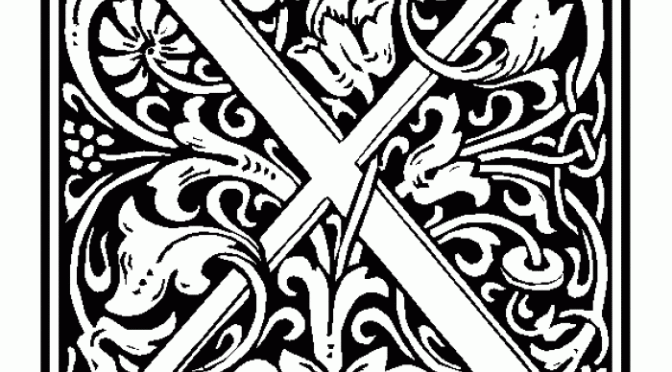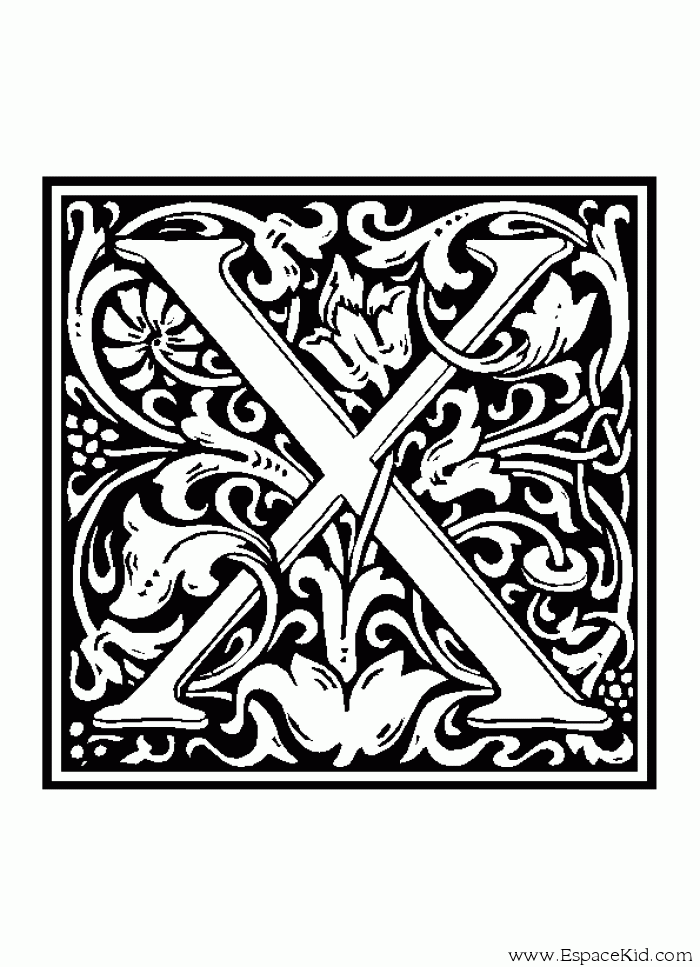Le Challenge a débuté tout en douceur… Mais, avec la lettre B, nous passons à table sérieusement… Et nous partons en Picardie où je vous propose de préparer un Bisteu ou Bigalan…
C’est un plat du terroir roboratif et rassasiant ! Un plat plutôt hivernal, le genre qui vous réchauffe des ravages du mauvais temps !
Le Bisteu est une tourte à la pomme de terre…Autrefois, il était réalisé dans toutes les fermes picardes et constituait, à lui seul, le dîner accompagné d’une salade.
C’est grâce à Antoine Augustin Parmentier (1737 -1813), enfant du pays, que la pomme de terre est devenue très présente dans la cuisine picarde, le climat et le sol picard favorisant la culture de la tubercule. D’ailleurs, en Picardie, la production de pommes de terre arrive au deuxième rang national.
Quant à l’origine du nom « Bisteu », il viendrait du patois picard désignant le « pain bis », un pain avec lequel le Bisteu était réalisé jadis.
Ailleurs, on trouve des recettes similaires, notamment en Provence où le pâté de pommes de terre est appelé : flaouzou, flouzou ou flouzon.
Pour réaliser un Bisteu, il vous faudra :
Ingrédients pour 4 : 2 pâtes feuilletées ou brisées (au choix) – 600 g de pommes de terre à chair ferme – 400 g lard fumé – un gros oignon ou deux petits – 30 cl crème liquide – un œuf – sel & poivre
Epluchez l’oignon et émincez le.
Epluchez les pommes de terre, lavez et coupez en fines rondelles.
Coupez le lard en morceaux
Foncez un moule à haut bord avec une pâte feuilletée ou brisée. Etalez une couche de pommes de terre.
Ajoutez l’oignon émincé et les lardons.
Salez modérément & poivrez à votre convenance.
Répétez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients.
Versez la crème sur la préparation.
Couvrez avec la seconde pâte feuilletée ou brisée.
Joignez et soudez les bords soigneusement.
Dorez avec le jaune d’œuf.
Ménagez une cheminée au centre en incisant la pâte.
Placez dans le four préchauffé à 180° pendant au moins 1h15
Servez chaud accompagné d’une salade de chicons (endives)

Pour terminer ce repas picard, je vous suggère un « café polisson » ou une « bistouille » : c’est un café additionné d’eau de vie.
Comme on dit : « Cha récauffe eul’coeur ! »
Sources : http://jna.pagesperso-orange.fr/
Photos : Collection personnelle



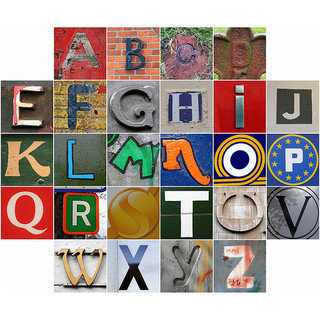

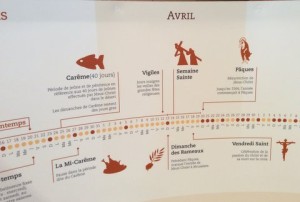
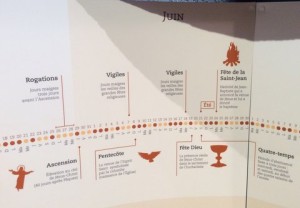 Il leur fallait bien du talent pour adapter leur cuisine… Et du talent, ils en avaient !
Il leur fallait bien du talent pour adapter leur cuisine… Et du talent, ils en avaient !